Mise à jour 15 janvier 2017
ANNEXES
Mai 2011
Les pages de Mémoires croisées ont été écrites entre 1999-2003, le triage de mes imposantes archives ne fait que commencer. J’avais donc laissé en suspens les ajouts de documents qui permettaient de complexifier les souvenirs, le regard sur l’Université des années 70-90, les changements qui s’opèrent, et de pointer aussi les problèmes qui se pérennisent…
Mais, les documents d’archives débordent les visées premières : ils permettent, entre autres, de confronter la mémoire et ses oublis, le vécu et le réel. Je suis souvent étonnée par la quantité de choses oubliées qui, au plan du vécu paraissaient secondaires, mais qui, ont eu et ont de l’importance. Les visées qui commandent le tri (je ne peux pas publier toutes mes archives!) ne peuvent donc pas prétendre maîtriser les effets des documents publiés. Et c’est bien ainsi.
Par ailleurs, retracer le fil chronologique d’une carrière m’a conduit à négliger d’autres aspects importants. Mon activité dans l’équipe de recherches du CNRS qui avait pour objet l’étude du théâtre était redoublée par une intense fréquentation théâtrale, à un moment où la majorité des théâtres avaient encore des troupes, dirigées par de grands metteurs en scène. Les années 70 – 90 (ça commence en 1954 avec Brecht) sont théâtralement flamboyantes. Mes archives théâtrales sont donc aussi riches que mes archives universitaires, et me rappellent non seulement la richesse de cette activité, mais réaniment des émotions intellectuelles d’une rare intensité. Quand je sortais des spectacles de Giorgio Strehler, par exemple, je planais ! Et les spectacles du collectif Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, avec ces traversées du Parc de Vincennes, le froid en hiver, ses tabourets inconfortables… mais que n’aurait-on enduré pour 1789, 1793, Molière, et caetera. Théâtre auquel Denis Bablet* qui dirigeait l’équipe, a consacré une étude. Des théâtres venant des quatre coins du monde, qui portaient nos luttes (anticoloniales entre autres), entretenaient le feu sacré de l’utopie… Je suis donc souvent tentée de briser la cohérence des enchaînements chronologiques par des détours théâtraux. De plus, j’aime le cinéma, ma drogue hebdomadaire, et lui aussi me gratifia de belles émotions contrastées qui se réactivent en relisant des articles découpées dans le Monde, aujourd’hui jaunies et imprégnées de poussières qui subrepticement envahissent mes narines, voilent mes yeux. Articles que je scanne, ne pouvant me décider à les jeter, de peur de perdre les remémorations qu’ils font affleurer. J’ai revu, récemment Gertrud de Dreyer, je me souvenais de toutes les scènes, mais pas dans l’ordre du montage de Dreyer.
Activités multiformes qui enrichissaient ma pratique d’enseignante. Pour partager l’expérience du Théâtre du Soleil, j’ai organisé des sorties sur Paris pour les étudiants rémois, grignotant ainsi le budget de sortie des géographes.
* BABLET Denis et BABLET Marie-Louise, Le Théâtre du Soleil ou la quête du bonheur, diapolivre, Editions du CNRS, Paris, 1979
*
ANNEXES se composent (dans l’état actuel du tri) de quatre types de documents :
I. Des formes de combat (interne/externe) qui complètent le FRAGMENT a* :
I.1. Tract et contre tract de la section rémoise du SNES-Sup, sur un sujet très conflictuel de la société des années 70 : l’avortement
I. 2. Copie de la lettre envoyée par la section rémoise de la Faculté au Président d’Université pour parer à la menace qui pesait sur ma titularisation.
II. Des extraits de lettres sur la praxis d’enseignement et ses multiples problèmes qui, rétrospectivement, me semblent constituer une sorte de manifeste contre certaines réformes de l’époque. Compléments aux FRAGMENTS a*, a**.
III. Des lettres plus théoriques qui précisent des parcelles du paysage mental de l’époque, ses polémiques, thématiques… :
III.1. L’une sur le mythe comme objet introuvable, adressée à Marcel Détienne, auteur de l’Invention de la mythologie, ouvrage aux effets ravageurs qui souleva une polémique hargneuse. La Lettre est restée dans mes tiroirs avec bien d‘autres projets… Une parcelle des années 80.
III.2. L’autre sur Brecht et la Chine, lettre d’information, adressée à une collègue chinoise, rencontrée lors d’un voyage en Chine en 1993. Une parcelle des années post-68.
IV. Une lettre adressée le 10 Octobre 1984, à une étudiante qui faisait état de sa «qualité de fille d’émigré, d’OS…». Lettre qui témoigne des changements post-81 et des problèmes — nouveaux — auxquels nous devions faire face. Le discours victimaire, auto-lissant, se pointait…
*
ANNEXES du FRAGMENT a**
I. TRACT. Combat pour l’avortement
Officieux :
Une femme qui ne veut pas d’un enfant est prête à tout, la loi a donc toujours été contournée. Dans les années 60-68, il existait de petits réseaux d’aide aux femmes qui voulaient avorter en Suisse. Après avoir vu un médecin, on pouvait aussi acheter des préservatifs féminins et des crèmes spermicides, à un moment où, en France, demander un spermicide dans une pharmacie relevait de la provocation. Lors d’un stage à Besançon, je passais souvent la frontière, dépêchée par des amis/amies parisiens qui passaient commande. Certains douaniers confisquaient le matériel, d’autres se contentaient de dire, en riant : vous, vous ne vous ennuyez pas ! Admiratifs, semblait-il.
Officiel
Le combat s’engagea ouvertement après Mai 68. Un processus historique d’une dizaine d’années qui a fait changer « l’opinion», majoritairement hostile selon les sondages.
Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur publiait un manifeste qu’un journal satirique appellera le manifeste des » 343 salopes «
1972 : s’ouvrait à Bobigny le procès d’une jeune fille de seize ans, violée. Les auxiliaires (au sens proppien) sont également inculpées. Procès retentissant qui fit avancer le combat de quelques mètres.
1974 : Simone Veil, ministre de la santé de Valéry Giscard d’Estaing; libéralise la contraception et s’engage sur l’avortement
17 janvier 1975 : loi Veil sur l’IVG dépénalisant l’avortement, définitivement votée, le 30 novembre 1979
Mais, aucun acquis n’est définitif. Notre tract était une réponse à la LA DÉCLARATION DES PROFESSEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS DE FRANCE, signée par des noms prestigieux. Relevons le « DE FRANCE » qui ne manquait pas de prétention…
2. Tract de la section syndicale du SNES-sup (Lettres). Le tract a été signé par des enseignants de différentes universités.
✥
I.2. Lettre syndicale préventive au Président d’Université, M. Devèze
L’ Administration communiqua — à la veille des vacances — la répartition des transformations d’emplois d’assistants en emplois de maîtres-assistants, le SNES-Sup, dans une circulaire du 10 juillet 1973, mit en garde la section rémoise contre « des tentatives d’attribution à la sauvette sans contrôle démocratique des élus», alors même que « les transformations » constituaient « une mesure de réparation essentiellement administrative » arrachée « au gouvernement pour pallier en partie ses carences concernant les créations d’emploi » ? La section rémoise adressa la lettre qui suit à la Présidence.
Reims le 17 Juillet 1973
Monsieur le Président,
Vous avez sans doute déjà reçu du Bureau National du SNES-Sup une lettre (dont vous trouverez copie ci-jointe) précisant la position de notre syndicat au sujet de la répartition des transformations d’emplois d’assistants en emplois de maîtres-assistants.
La section Reims-Lettres du SNES-Sup a attiré votre attention à plusieurs reprises depuis le début de l’année sur ce problème, auquel elle attache la plus grande importance. Vous serait-il possible de lui faire connaître le nombre de transformations accordées à l’Université de Reims ?
Elle estime, contrairement à l’opinion émise par un enseignant au Conseil de l’UER des Lettres du 1.6.1973, que la transformation de poste est une mesure administrative et non pas une promotion sur dossier.
Elle se permet d’insister sur le cas particulier des Assistants des Lettres, qui ne sont pas titulaires de l’Enseignement Supérieur et pour lesquels la transformation de poste ne représente pas seulement un avantage financier, mais aussi une assurance concernant la garantie de l’emploi.
Il se trouve, en outre que, selon les critères définis par le secrétariat et le Bureau du SNES-Sup, trois de nos syndiquées figurent en tête de liste des transformations possibles, dont l’une a déjà été victime de manœuvres en raison de ses opinions politiques et syndicales ; la Section Reims-Lettres du SNES-Sup vous serait particulièrement reconnaissante, de veiller à ce que ces enseignants ne subissent aucun préjudice du fait de leur appartenance syndicale.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments respectueux.
Pour le Bureau, Le Secrétaire de Section.
P. Guérémy .
La prévention fut efficace. Aucune manœuvre ne put empêcher ma titularisation.
✥
De la Praxis pédagogique et ses problèmes…
II. Extraits de lettres adressées aux instances administratives, syndicales, dans lesquelles j’essayais de poser des problèmes pédagogiques. Toujours d’actualité, étant donné que deux logiques s’affrontent en permanence dans l’enseignement : celle de la structure et celles de la pédagogie (les répétitions d’une année sur l’autre en témoignent). La première tente de résoudre des problèmes d’organisation, et les contraintes sont grandes, la seconde, plus souple, cherche, entre autres, des solutions pour remédier à certains problèmes d’organisation technique, sans renoncer à ses visées.
Ne parvenant pas à transférer sur le site la numérisation des lettres originales, en attendant de trouver la solution, je commencerai par publier des extraits de lettres diverses qui témoignent des difficultés de l’Université, qui de manière permanente, se heurte au manque de moyens, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, mais aussi à des contraintes systémiques. Ce qui n’empêche pas les médias, les politiques, etc., de déplorer le manque d’initiatives, les « blocages » à la modernisation. Et caetera.
Il n’est pas possible de réformer efficacement l’enseignement, ni même d’en parler, si on ne connaît pas l’institution de l’intérieur, si on ignore la fatigue nerveuse d’un cours interactif, et ce quel que soit le nombre d’élèves. Quand j’ai quitté l’enseignement secondaire, je le répète, j’ai eu le sentiment d’avoir abandonné le bagne. Un ami saint-cyrien et poète qui désirait quitter l’armée pour l’enseignement, prépara l’agrégation d’histoire, fit un stage d’un mois dans un lycée. Il ne cessait de répéter que c’était vraiment très fatigant nerveusement, qu’il comprenait la fatigue de sa mère (enseignante)… Il renonça à quitter l’armée.
*
II. 1. Manque chronique de moyens ET contraintes systémiques
L’U.V. de licence 418 sur les Avant-gardes (Programme des années 75) dont j’étais responsable, est un bel exemple des difficultés auxquelles se heurtent les rénovations pédagogiques. Je précise qu’à Reims, nous (département de français, SNES-Sup) avions dû ferrailler pour introduire le système des Unités de valeurs (U.V.), une sorte de service à la carte, qui aurait facilité, entre autres, les ‘reconversions’.
J’ai retrouvé une lettre de 1975, adressée à M. ANTORMARQUI, Administrateur provisoire de l’U.E.R, concernant cette U.V. Comme je l’ai dit, l’U.V. 418 était présentée comme une U.V. expérimentale, dirigée par trois enseignants, présents durant trois heures. L’U.V., obligatoire pour les étudiants de français, niveau licence, était ouverte à des étudiants d’autres disciplines, de même niveau, elle avait donc un double statut U.V. obligatoire / U.V. optionnelle. Elle fut très fréquentée par les étudiants allemands (politisés), une vingtaine dans les années 75 à venir à Reims. Dix-huit participèrent aux «cours dialogués» et au travail en atelier. Trois étudiants de médecine et un philosophe, aux motivations hétérogènes devinrent des étudiants assidus. Nous avions donc scindé le groupe d’environ 40 étudiants en deux pour les travaux pratiques. MAIS, en fin d’année, seuls les 18 étudiants de français se présentèrent à l’examen dans la cadre de la licence.
Ne tenant pas compte de la présence des étudiants étrangers et d’autres disciplines, on nous reprocha d’avoir scindé le groupe pour « 18 étudiants » seulement ! J’écrivis donc pour rectifier «l’erreur».
Extraits de lettres
Après avoir expliqué le caractère expérimental de l’ U.V., je fis un certain nombre de remarques qui débordent largement la question locale :
« Pour résumer : 18 étudiants ont présenté l’U.V. dans le cadre de la licence, mais le nombre de participants a toujours été plus élevé.
Si à la rentrée prochaine, nous n’obtenons pas 5 heures pour cette U.V. [cours+ TP], nous ne continuerons pas l’expérience.
Je ne défendrai pas la forme expérimentale de l’U.V., je ferai simplement remarquer que cette U.V. connaît une audience locale certaine, favorisant l’interdisciplinarité, et que, d’autre part, elle associe de manière très étroite l’enseignement et la recherche. G. Scarpetta travaille sur les avant-gardes françaises contemporaines, J. Epstein (CNRS), sur les avant-gardes cinématographiques et moi-même sur les avant-gardes allemandes et russes des années vingt-trente. Cette U.V. permet donc la confrontation des hypothèses de travail et des résultats.
L’Université à qui l’on reproche, par ailleurs son conservatisme, son manque d’initiatives, etc., est-elle condamnée à ne jamais innover faute de moyens ? (et dans notre cas, il s’agit de 3 heures supplémentaires !).
L’innovation resterait-elle un privilège parisien, vincennois ?
De plus, nous avions l’intention d’ouvrir certaines parties de l’U.V. à l’Université du 3e âge en 1975-1976 ».
Réponse manuscrite dans la marge de la lettre :
« Il n’est pas possible dans l’état actuel de nos finances de financer une U.V, même ‘expérimentale’ à raison de + de 3 h pour 18 étudiants ou 25 étudiants dont des auditeurs libres. Dans tous les domaines, quelles que soient les circonstances, il faut toujours (double souligné) faire des choix ».
L’UV est donc revenue à une forme plus traditionnelle, moins coûteuse pour l’U.E.R, au grand regret des étudiants/tes, prêts à la défendre.
Mais, le manque de moyens n’explique pas tout. Dans un compte rendu du Conseil de Département de français du Jeudi 27 novembre 1975, que j’avais oublié, il était question, de supprimer une majorité d’U.V. optionnelles, pour pallier, entre autres, les manques des étudiants.
« Les enseignants de Littérature française remarquent que les étudiants ignorent tout de l’histoire littéraire.
1° sur les deux options offertes actuellement en 1ère année, l’une deviendrait une U.V. obligatoire d’histoire littéraire à laquelle pourrait participer des enseignants d’autres sections (par exemple, la Littérature comparée). Ce serait une U.V. de 4h 30.
[…]
2° Il faudrait réduire les U.V. optionnelles à une seule par section, mais en augmenter l’importance, 4.30 au lieu de 3h.
Les U.V. optionnelles — oxygène des étudiants (pouvoir choisir et s’ouvrir à autre chose que sa discipline) et des enseignants (enseigner sur un sujet de prédilection, polar, poésie… ) — butaient aussi sur des problèmes d’emploi du temps. L’U.V. 418 intéressait des étudiants d’histoire, de philosophie, d’allemand, mais leur emploi du temps leur interdisait de s’y inscrire. Sans parler de l’organisation des examens ! Progressivement donc, les contraintes du système, obligeaient à revenir à des modes de fonctionnement plus traditionnel. Le dilemme est permanent. L’interdisciplinarité, pourtant nécessaire, l’ouverture de l’Université sur l’extérieur, et autres grands principes semblent devoir rester des idées utopiques de rêveurs, l’année universitaire n’est pas extensible, parce que le temps n’est pas extensible.
II. 2.
13.5.87. Extrait de lettre à P. Guérémy (géographe), syndicaliste du SNES-Sup, pour protester contre des suppressions d’Unités de valeur (UV) pour satisfaire à des critères administratifs .
« […] MAIS une question se pose alors : le critère administratif est-il un bon critère pédagogique ? C’est étrange et fascinant, de constater que TOUTE institution finit par fonctionner de manière autonome, en oubliant ce pour quoi elle est destinée ! Dans les hôpitaux, tout est organisé en fonction des horaires des laboratoires, médecins, aussi te réveille-t-on à 6h du matin, alors que tu es malade ! Certaines facs organisent les cursus en fonction des problèmes administratifs. (Un bon exemple des contraintes de la structure).
Question : d’un point de vue pédagogique, on pourrait peut-être se demander si le Contrôle continu doit nécessairement déboucher sur un examen final dans TOUTES les disciplines. Ne faudrait-il pas repenser le système des examens, faire des propositions au ministère en fonction de l’expérience acquise ? C’est parce que Reims interprète tout à la lettre que le système des examens devient de moins en moins gérable. Pourquoi ne pas explorer des solutions pédagogiques ?
Prenons un exemple : l’UV 415 qui se compose d’un cours général (Chardin), de deux sous-cours + TD, portant sur des sujets particuliers : le Picaresque, le Réception ou le Conte ou …, l’examen ne porte que sur le cours de Philippe, seul moyen pour lui de vérifier l’acquis. Dans les deux autres cas, c’est la note de contrôle continu qui est prise compte. Normalement, il devrait y avoir 3 examens, puisqu’il y a trois sujets différents. Suivant l’enseignement et l’enseignant, le système peut fort bien être amélioré, assoupli, SANS DOMMAGE pour les étudiants. Par exemple, en 418, la présence obligatoire aux travaux pratiques où s’expérimente l’analyse des textes est une forme de sélection, ne viennent que ceux/celles prêts à s’investir. En fin d’année, ils me remettent un dossier qui me permet de vérifier le travail global et l’acquis méthodologique, l’examen n’a pour moi qu’un intérêt mineur. Je pourrais m’en passer. Les organisations rigides ne visent-elles pas plutôt à se donner bonne conscience ? […] »
II. 3.
Années 1988-1989. Extraits de lettres adressées à la Directrice de la Faculté, posant différents problèmes et à nouveau la question du critère administratif.
Examens et UV optionnelles
Avec le système des UV, l’organisation des examens était devenue ingérable, un seul étudiant de géographie qui avait opté pour une UV optionnelle de Littérature comparée, pouvait gripper le planning, allonger la période des examens et donc réduire la durée des cours. La solution administrative classique visait la suppression de l’obstacle, en ce cas, la suppression de l’option (une forme intéressante d’ouverture sur une autre discipline); de mon côté, la venue d’étudiants d’autres disciplines me paraissait positive, je pensais donc qu’il fallait repenser la question de l’examen en fonction de la discipline.
a) « Au sujet de la fraude lors des examens qui vous préoccupe tant : je pense qu’on devrait distinguer les UV à risques* et les UV sans risques. Je m’explique avec un exemple. Généralement, dans le cadre du Contrôle continu, je fais faire des dossiers, mais étant donné le nombre d’étudiants en 2e année, j’y avais renoncé pour le 2e groupe, ne pouvant pas corrigé 40 dossiers en juin. J’ai donc fait faire un devoir sur table (durée indéterminé + 6 heures si). Ils devaient appliquer la méthode de Propp à un récit ‘mythique’. J’avais autorisé toutes les notes, y compris le texte théorique de Propp, dictionnaires, etc. Je les ai observés, tous ont consulté l’ouvrage de Propp. MAIS, à la correction, il y avait une différence majeure entre ceux qui avaient travaillé sérieusement sur Propp et qui donc maîtrisaient la théorie, et ceux pour qui la consultation était une première lecture. C’est ce que j’appellerai une UV sans risque.
[* risque = fraude dénoncée par les ‘collés’, «moi je suis collée parce que je ne triche pas ! », propos souvent accompagnés de larmes… Une source d’étonnement pour ma génération qui trouvait normal d’être collée, sans en faire un drame. Je leur répétais que j’avais été collée 3 fois en thème allemand pour UNE faute de grammaire (Le professeur Colleville était intraitable) et que j’aurais trouvé indigne de verser une larme. Je me remettais au travail pour éviter UNE faute de grammaire. Manifestement, les temps changeaient et les mentalités étudiantes aussi.]
Au vue de cette expérience, je me demande si les UV à risques ne sont pas — aussi — des UV trop répétitives. Je suis convaincue qu’on devrait pouvoir trouver dans toutes les disciplines des sujets qui permettraient de vérifier les acquis sans pour autant obliger les étudiants à répéter les cours. Dans le cas où cela n’est pas possible, l’UV pourrait être considérée comme UV à risques, et surveillée par une personne de l’extérieur et un enseignant.
Mais, je vous entends ! Un nouveau critère viendrait encore compliquer l’organisation des examens. À Jussieu, les étudiants ont 25 UV, ils organisent bien leurs examens !
Je pense qu’il faudrait repenser le problème des examens. Vieux problème 68tard et toujours actuel.
b) Un autre problème qui, lui, devient crucial avec l’accroissement du nombre d’étudiants : la fameuse semaine d’information pour les étudiants. En Français, pour les premières années, on a poussé le zèle jusqu’à émietter l’information sur la semaine, faisant bon marché du temps des enseignants. Il est évident qu’il est devenu impossible de demander à Mme Lobjoit [Secrétaire du département de Français] d’assumer seule les inscriptions, mais j’estime que ce n’est pas à nous de le faire, mais aux étudiants.
En Allemagne, mais pas seulement, les étudiants versent une cotisation à un organisme qui les représente l’ASTA, qui prenait en charge, quand j’étais Heidelberg, l’information, la notation des enseignants, voire la création de crèches, etc. C’est une grosse machinerie qui accomplit un énorme travail. Quand j’étais étudiante, à la Sorbonne, il existait des CORPO qui nous apportaient aide et conseils. Pourquoi ne pas tenter de renouer avec cette tradition. Ne pourrait-on pas envisager le versement d’une cotisation (40-50 frs) reversés ou versés directement aux départements qui pourraient s’en servir pour payer des vacations à des étudiants de 3e année qui, à la rentrée, se chargeraient d’informer leurs camarades ?
Ceci aurait le mérite :
1) d’impliquer les étudiants sans faire appel à leur « dévouement » (j’ai horreur de cette notion) ; et peut-être de développer une dynamique (plus de solidarité, conscience plus grande de leurs responsabilités à l’intérieur de la fac, etc.);
2) d’économiser le temps des enseignants dont on fait un usage de plus en plus inconsidéré ;
3) de briser la dynamique mater-paternalisante qui se met en place et que je trouve dangereuse sur tous les plans : pour les étudiants, il s’agit d’un assistanat infantilisant. Quant aux enseignants, ils deviennent corvéables à merci, ce qui a pour effets évidents de secondariser l’enseignement supérieur. Après le lycée, la liberté universitaire me comblait, même si cette liberté avait un prix !
Je pense par ailleurs que les séances d’information devraient se faire avec les enseignants du secondaire, se passer hors nos murs, un enseignant du supérieur pourrait présenter nos exigences, nos attentes. Ce qui aurait le mérite de sensibiliser les enseignants du secondaire aux problèmes de formation des élèves de plus en plus appelés à aller à l’Université — cette voie de garage pour chômeurs potentiels, (ne nous cachons pas cette vérité). […]
J’aimerais bien ne pas être seule à résister sur cette pente dangereuse. Non seulement, on nous a dévalorisés moralement et financièrement, mais on fait de plus en plus appel à notre dévouement, je me considère comme une salariée et non comme une missionnaire, dans un métier où précisément (moi y compris) on a tendance à s’auto-exploiter.
30.3.88
Puisque ma lettre s’est perdue sur mon bureau, j’ajouterai une autre suggestion.
Ne pourrait-on envisager la création d’un DEUG européen, en vue de 1992 ? Un DEUG de culture générale, avec trois langues, ce qui permettrait à des étudiants européens de rédiger dans leur langue, au même titre que les Français. Dans ce DEUG, il faudrait ne pas oublier la culture scientifique, sous forme de cours sur l’Histoire des sciences par exemple, car je trouve aberrante, en cette fin de 2e millénaire, cette absence de culture scientifique chez les littéraires. Évidemment, les comparatistes se tailleraient la part du lion, étant donné leur vocation transculturelle. Ce DEUG pourrait déboucher sur la création d’atelier de traduction, en rapport avec des maisons d’édition.
Je souligne culture générale, car les DEUGs professionnels sont une illusion, sécurisante pour certains, dans une société où personne n’est capable de nous dire quelles sont les professions d’avenir dans les cinq ans à venir ; ce qui explique qu’en 1988, il manque dans le Génie civil (pour prendre un exemple que je connais) de la main-d’œuvre qualifiée à tous les niveaux ! Quoi qu’il en soit, il importe de penser notre avenir en fonction de 1992.
Un dernier grain de sel : je ne pense pas qu’il faille renforcer les DEUGs. QUAND peuvent-ils travailler ? D’autant que les étudiants rémois sont nombreux à gagner leur vie. Il faudrait diversifier les DEUGs, mais non les alourdir.»
Proposition restée sans échos. Farfelue ?
La question des conditions de travail du personnel administratif.
« Quelques remarques au sujet de l’informatisation des résultats, mais peut-être vous a-t-on déjà dit ces choses… Il faudrait repenser le problème. Au lieu de faciliter le travail, l’informatisation le complique ! Il faudrait à mon sens, un double système : P(procès)V(erbal) comme les années précédentes et archivage des données APRÈS. Si une secrétaire craque et Mme Lobjoit était arrivée aux limites du supportable, tout est bloqué. En octobre, l’informatisation + la globalisation des 1e et 2e années qui complexifient singulièrement le travail des secrétaires + les inscriptions, les demandes des étudiants… = l’enfer. Même quand nous ‘rentrons’ nous-mêmes des résultats, ce que nous avons fait pour 414, on allège à peine son travail. Ajoutons que la complexification des tâches des secrétaires ne s’accompagne d’aucune revalorisation salariale et statutaire. Il serait temps que l’Université fasse un rapport au ministère pour attirer son attention sur les conditions de travail dans les petites facultés […]. Je crois qu’il faudrait demander aux secrétaires de faire le bilan de l’expérience et repenser la question. C’est urgent ! L’informatisation doit simplifier les tâches et non les alourdir. »
[Note. Madame Lobjoit était la secrétaire du Département de Français. Sans elle, nous étions perdus. J’ai souvent raconté à son sujet la blague soviétique des deux lions à l’entrée du Kremlin. L’un, le moins intelligent, dévora une secrétaire, l’autre, plus futé, un bonze du Parti. Personne ne remarqua la disparition du bonze, mais tout le monde était à la recherche de la secrétaire, le lion dévoreur risquait gros …]
II.4.
Extraits d’un échange avec le Secrétaire départemental du SNES-Sup (novembre 1989) :
«— au sujet de ta lettre. Oui, c’est ainsi, les gens voient ce que tu NE fais PAS, mais non ce que tu fais, ce qui explique que tu as reçu plus de lettres de protestation que de lettres de félicitations ! Quand je faisais du travail pour deux, personne n’a rien trouvé à dire, on devait penser que je prenais mon pied à faire des motions, à me battre dans les conseils, etc., à avoir des nuits sans sommeil par énervement. Maintenant que je ne fais rien, on se croit obligé de le remarquer ! Expérience intéressante ! Ma vie durant, je suis battue sur le plan privé pour qu’on ne considère pas les gestes que tu fais pour une raison ou une autre, comme un dû, et je constate que sur le plan public, c’est exactement la même chose avec des gens qui te sont étrangers ! Faut donc se dire, philosophiquement, que c’est humain, rien qu’humain ».
II. 5.
En avril 1989, je revenais sur la question des langues en Lettres modernes, dans une lettre à M. Chardin, nouveau directeur de la minuscule section de Littérature comparée.
« Une suggestion. Je pense qu’il faudrait revenir lentement aux langues en Littérature Comparée : textes étudiées dans sa langue et épreuve de langue comme on le faisait pour le certificat de LC dans les temps anciens… 1992 nous y pousse, et de plus, les étudiants de 2è année continue de n’avoir pas de cours de langue, or la maitrise d’une seconde langue doit devenir la règle en Lettres Modernes. On serait plus efficace sur ce plan que par notre participation aux autres UV, inaugurée l’an dernier. Si moi, j’ai eu plaisir à retrouver Nerval et les problèmes de traduction de la poésie, les étudiants de l’UV POÉSIE, eux, ont flotté ! On pourrait commencer avec les moyens du bord (anglais, allemand), si nous avons un poste, il faudrait recruter un hispanisant. En licence, je voudrais ajouter une heure ou 1/2 h et prévoir une épreuve de langue en anglais ou en allemand. »
II. 6.
En novembre 1989, je revenais sur les critères d’élimination dans une longue lettre à Michel Picard, Directeur du département de Français, que j’avais intitulée, Méditation d’une Martienne sur les changements en cours. Je reposais, entre autres, la question du critère administratif comme critère normatif.
« […] Revenons au problème : la nouvelle direction a tendance à aller dans le sens des directives gouvernementales, à tous les niveaux, les syndicalistes sont devenus eux-mêmes de bons gestionnaires sans couleur. […]
J’avoue que la suppression d’UV comme ROMAN et POÉSIE me paraît fou, d’un point de vue, non pas administratif, mais pédagogique. Pouvoir choisir entre l’une ou l’autre est quand même important. Pourquoi dès que le nombre d’étudiants augmente, se croit-on obligé de supprimer les avantages du système à la carte ? Le département d’anglais serait-il le modèle enviable ? Avec ces UV, les enseignants se font plaisir, dit-on, et alors ? Comme si le plaisir n’était pas une condition d’un enseignement de qualité. Dans l’UV obligatoire, lourde de seconde année, j’ai peu de plaisir à enseigner, et je puis t’assurer que l’atmosphère n’est pas la même que dans l’UV 418 ! C’est aussi le plaisir d’enseigner qui génère le plaisir d’apprendre ! Supprimer ces deux UV, revient à pénaliser les enseignants responsables, enseignants qui ploient sous les charges de la Première année ! Ces UV sont leur ballon d’oxygène !
Enfin, il serait quand même ‘BIEN-séant’ de mettre les étudiants dans le coup ! Ils ont peut-être des choses à dire, les UV optionnelles ne représentent-elles pas pour eux, aussi, un peu d’oxygène ? J’ai posé la question en 418, ils trouvaient le nombre des optionnelles trop réduit à Reims. Sont-ils les seuls ?».
Dans la même lettre, je posais un problème plus général dont voici les termes. Je m’interrogeais sur le COMMENT
« empêcher, freiner, les dérives, et surtout l’intériorisation d’une culpabilité rampante que je ne parviens pas à comprendre ; car même si on ne fait pas de zèle, on fait plus de quarante heures par semaine, or nos salaires sont ridicules, je finis sur le salaire d’un débutant (on a offert à mon neveu 11 000 F, lui qui n’a pas encore fini ces études !). […] Parfois, je me demande si je ne suis pas martienne, car je ne comprends pas les collègues. Pourquoi acceptent-ils d’être culpabilisés ou pis, de l’être au point de vouloir culpabiliser les autres. […] Culpabilisation bien orchestrée par les médias à travers la hiérarchisation des facs, comme si on pouvait obtenir les mêmes résultats avec des étudiants préparés dans les grands lycées parisiens et des étudiants de milieu modeste, que le niveau scolaire de la région champenoise a contribué à déclasser. J’ai écrit au Monde dans ce sens, évidemment ils font silence. […]
Je crois qu’il faudrait qu’on constitue un noyau de résistance pour freiner la dérive vers l’université-entreprise-rentable, au moins au niveau du département. Je manque de temps pour une action de plus grande envergure, aussi longtemps que je n’aurai pas bouclé le travail en cours. Il n’est pas normal que l’emploi du temps de notre collègue Prince soit aussi fragmenté, il me disait avoir été plus disponible quand il était au lycée avec ses 14 heures que maintenant. Je rencontre Wieczoreck qui me dit, ne plus avoir le temps de faire la moindre recherche… Je me moque de savoir si certains enseignants ne font plus de recherche depuis des lunes, toutes les professions ont leurs brebis, les étudiants ont aussi un rôle à jouer, qu’ils le fassent.
C’est d’autant plus écœurant, que j’ai deux amis scientifiques dont l’un à Orsay, à qui on ménage des plages de temps libre importantes, précisément pour qu’ils puissent faire de la recherche : l’un fait 150 heures sur UN trimestre, il est libre à partir de Février […] On transforme les facultés de Lettres en entreprise, fabricant au rabais les futurs enseignants, alors que l’Europe est à nos portes, que les universités doivent être aussi des lieux de réflexions théoriques. Qu’il faille changer en fonction des nouveaux étudiants, d’accord, mais qu’on réfléchisse aussi un peu sur les implications de certaines réformes, car enfin, comment peut-on faire un enseignement du supérieur, quand on a plus de 3 programmes différents ? En fait, on transforme les facultés en collège littéraire, les choses importantes se faisant ailleurs. Dans les grandes écoles !
Par moment, je me demande s’il ne faudrait pas prendre l’initiative d’un manifeste pour dénoncer l’université qui se met en place sous couvert de modernisation. Cette université tend à développer un modèle de prof, bon technocrate, je n’ai rien contre, à condition que ce type de prof ne tende pas à éliminer des esprits plus aventureux. Non pas défendre l’université de papa, mais développer l’université comme lieux de réflexion, ce n’est pas élitiste, mais vitale. Évidemment, ça dépend des profs, mais encore faut-il que la diversité des approches, des conceptions soit possible. Quand tu penses que quelqu’un comme Miguel Abensour, collègue de la fac de droit, connu par ses travaux dans le champ de la Philosophie politique, ne trouve pas preneur sur la place du savoir, tu t’interroges…
J’ai le sentiment qu’on va encore rater la modernisation. Exemple : en 1992 naîtra l’Europe. Les langues vont devenir de plus en plus importantes. Au niveau microscopique, on aurait pu en Littérature comparée accroître la place des langues, au lieu d’étendre la L.C (comparée) à d’autres UV, Roman, Poésie, c’est-à-dire en fait prendre des heures à nos collègues Pillu, Prince, [responsables de l’UV ROMAN] et aggraver ainsi leurs conditions de travail, on aurait pu redonner à la L.C la dimension linguistique qui était la sienne, quand j’ai préparé le certificat de L.C à la Sorbonne, on travaillait sur les textes en langue. J’aimerais parfois sonder le ventre des motivations ! Dire, vous aurez une épreuve de langue, sans leur donner des moyens de parfaire leurs connaissances en langue, c’est du replâtrage autoritaire, dont les étudiants sont conscients. »
J’achevais cette longue lettre ici réduite sur les effets de l’enseignement de l’UV 418, dans laquelle j’avais analysé des textes de Ph.K. DICK (Programme années 80). Une manière oblique de répondre au dédain de La science-fiction par des collègues universitaires.
« sur le plan pratique : des étudiants qui enseignent, se servent du travail fait en cours et parviennent à faire travailler, avec passion, des élèves de LEP, — l’une d’elle a travaillé sur le Temps désarticulé de Dick, et les élèves ont marché à fond, alors que personne ne parvenait à leur faire faire quoi que soit ; la même expérience m’a été décrite par une collègue luxembourgeoise (ex-étudiante rémoise que tu as peut-être connue, Manon Simon) ; enfin, et ce fut pour moi une surprise, étant donné ma capacité ‘naturelle’ à fictionner, la SF débloque leur imaginaire et donc quelque part leurs rapports à leur propre inconscient. Ils/elles me disent, « on est d’abord bloqué, on abandonne le livre, (Dick souvent), on se dit c’est fou, c’est pas possible… Et puis on y revient, pour relever un défi et parce qu’on a opté pour l’UV. Le blocage surmonté, après, c’est formidable ! ». Ils découvrent leur ‘fantasmatique’ à travers des préférences pour tel ou tel bouquin, se mettent à fictionner des situations impossibles, pense la société à travers les bouquins lus, le plus souvent très critiques !
Ça recoupe quelque part ta problématique de la littérature-jeu. […]
Je pense qu’il faudrait aussi donner une place au théâtre, à la pratique théâtrale, surtout pour de futurs enseignants, et ne serait-ce que pour améliorer leurs prestations orales, ils sont coincés dans leur corps, leur imaginaire, çà leur donnerait confiance en eux. Mon beau-frère a mis en scène, au Maroc, une pièce avec des aveugles, les changements physiques/psychiques faisaient miracle.
On peut rêver…
Comme je pense que tous les pouvoirs ont un flair infaillible pour détecter ce qui les menace, je me demande si ce type de réformes utilitaristes ne visent pas à mettre les futurs citoyens à l’abri des effets de la littérature, de l’art… Gauche, Droite, même combat ! »
*
… au plus théorique
III. 1
Lettre à Marcel Détienne, auteur de l’Invention de la mythologie. Une manière de donner un aperçu sur le travail qui m’absorba corps et âme, durant une quinzaine d’années.
Paris, le 10 mars 1996
Monsieur,
Relisant L’invention de la mythologie, et conjointement, l’ouvrage de Luc Brisson [Platon, les mots et les choses, Comment et pourquoi le mythe, Paris, La Découverte, édition, revue et mise à jour 1994, (1ère édition 1982)], j’ai pris connaissance de la polémique déclenchée, en son temps, par votre ouvrage. Elle m’avait échappé, car à l’époque de sa lecture, j’avais déjà abandonné le mythe, objet d’un corpus proposé aux étudiants de seconde année. Voici ce que j’en dis dans un travail en cours où je commence par faire l’historique de ma démarche :
« Dans les années 75, j’avais proposé aux étudiants de deuxième année, un programme sur le conte, ensuite sur le mythe. Pour tenter de cerner l’objet mythe, j’avais associé des récits de sociétés »exotiques’, sociétés dans lesquelles ces récits assumaient des fonctions diverses et repérables, et des mythes de la tradition occidentale (celtiques, mésopotamiens, grecs en particulier), ces derniers étant sources et modèles privilégiés des discours sur ‘LE Mythe’ en Occident.
Durant cette phase, en particulier dans le travail sur le mythe, s’accumulèrent durant trois ans, des masses de questions, induites — en partie — par une contradiction entre le théorique (comme discours-sur) et l’empirique (les récits analysés). D’une part, l’analyse des récits ne posait pas de problèmes majeurs — certains, même nombreux, fonctionnaient (en partie ou en totalité) comme des contes de type proppien — et de l’autre, le taxon mythe et les fonctions qui lui sont traditionnellement attribuées, devenaient toujours plus problématiques. Le rapprochement incongru de récits empruntés à des aires culturelles différentes, à l’ethnologie en particulier, avait eu pour effets de problématiser et le discours sur le mythe et la notion même de mythe avec ses fonctions traditionnelles. C’est-à-dire en fait, de mettre à bonne distance une notion grecque qui servait de taxon à prétention universelle, pour caractériser un certain type de récits, appartenant à des cultures radicalement différentes. […]
De plus, les discours occidentaux, par ailleurs si contradictoires, sur LE Mythe, planaient à des hauteurs telles qu’on ne savait plus de quoi il était question. Était-ce un discours ? un récit ? un discours religieux ? une forme de logique et, dans ce cas, de quel type ? Je soupçonnai cette notion d’assumer une fonction plus idéologique que théorique. Mais sans plus. J’abandonnai le corpus, très perplexe.
À l’époque, je n’ai pas songé à faire l’analyse de cette contradiction. La perplexité se doublant d’une certaine confusion. Cette exploration instrumentale (enseigner-sur), avait d’une certaine manière et à mon insu renforcé de ces idées qui relèvent de la philosophie spontanée, inconsciente, à savoir que la pensée mythique était une forme de pensée ‘primordiale’, dont on ne pouvait émerger qu’au prix d’un travail critique-toujours-recommencé. Dépourvue de connaissances préhistoriques, je devais porter en moi l’image, elle aussi courante, pour ne pas dire hégémonique, bien que grotesque, d’un humain qui, dans ses commencements, devait — comme les enfants (comparaison obligée) — confondre (entre autres choses) des interprétations mythiques du monde et le réel. Selon une autre hypothèse très répandue, d’évidence, que l’ontogenèse reproduirait la phylogenèse. Hypothèses qui ont conduit à des conclusions hâtives : le primitif étant à l’espèce humaine, ce que l’enfant est à l’adulte.
Images floues, implicites, chargées d’implications idéologiques comme toutes ces images culturelles qui nous habitent ou nous “pensent” à notre insu, quand on ne prend pas soin de les penser. Implications latentes qui, parfois à l’insu du sujet, s’explicitent. Par la suite, j’ai constitué des centaines de fiches témoignant de ce darwinisme philosophique qui irrigue tant de travaux occidentaux, même récents, post-lévi-straussiens sur le mythe, le sauvage, la pensée magique, mythique, la pensée imagée qui n’est pas capable, pas — encore — capable de s’élever à l’abstraction, l’alpha et l’omega de toute pensée digne de ce nom, dans une pensée ethnocentrée de l’abstraction, aux effets pervers dans leurs rapports aux Autres.»
Donc, quand votre livre parut en 1981 (date à laquelle, j’avais abandonné le mythe à son destin d’objet insaisissable), les conclusions auxquelles vous étiez parvenu, venaient conforter mes doutes. Par ailleurs, cet ouvrage d’helléniste, c’est-à-dire de spécialiste, confortait la généraliste que je suis, occupant un poste de Littérature comparée, je n’avais pas déliré en doutant de l’existence du mythe comme récit spécifique.
Dans les années 84, je suis revenue au mythe dans le cadre d’un travail personnel. Avec la naïveté de l’idiot deleuzien (naïveté qui a le mérite de produire un regard interrogateur et distancé). Les doutes que j’avais nourris se trouvèrent renforcés. En toute innocence, j’entrepris de vouloir remplacer cette notion chewing-gum, par une catégorie celle de l’Oblique, forgée dans le cadre de l’étude des avant-gardes des années vingt. Une manière de tenter de déplacer des questions. Et, après dix années de pérégrinations temporelles et spatiales dans les récits dits mythiques, je suis toujours plus convaincue de l’inanité de la notion de mythe.
Je tente actuellement de démolir cet objet dans un de mes chapitres. (D’où la relecture de votre ouvrage). Chapitre devant lequel j’ai toujours reculé, parce que je ne connais rien de plus ennuyeux, que d’avoir à s’imbiber de ces métadiscours sur le mythe pour en faire la critique. Métadiscours qui contiennent leurs anthropologies, souvent douteuses, de Mircea Eliade à Georges Gusdorf, ces références obligées des discours sur le mythe.
Quand je suis proche de l’asphyxie, je m’oxygène en faisant retour de temps à autre, à l’analyse de récits ‘exotiques’, amérindiens, en particulier, qui constituent un bastion de résistance. On comprend que Lévi-Strauss ait pu construire son île en quittant les océans mythiques de l’Occident gréco-chrétien. On mesure aussi l’ampleur de l’entreprise. Mais, le propos de Lévi-Strauss fut moins de définir le mythe comme récit spécifique, que d’explorer ce qu’il considérait être le fonctionnement de la pensée à “l’état sauvage”. Ce qui revenait, notons-le au passage, à transmuer des formes de production symbolique en structure de l’esprit. Aussi, s’est-il peu soucié de l’état des corpus, ou plus exactement, il s’en est accommodé, et en fin de compte, il a tiré de son point de vue, le meilleur parti du corpus tel qu’il était, sans se soucier de ce qu’il aurait pu être. D’où la cohérence de l’entreprise qui visait aussi à construire une machine de guerre contre les prétentions occidentales à LA Rationalité.
S’il est vrai que Lévi-Strauss a ouvert la voie en arrachant le mythe à son sérieux sacré, fonctionnant sur des systèmes d’oppositions fragiles — il n’a pas défait ce type de discours. La critique du structuralisme comme système a-historique, sans sujet, permet trop souvent, non pas d’en pointer les limites, mais de revenir à une tradition menacée.
Sur des objets aussi problématiques, il faut soi-même refaire certains parcours, avant de saisir le bien-fondé d’assertions apparemment hérétiques. En fait — et de manière quasi systématique — on peut dire qu’il suffit qu’on pense avoir trouvé un critère plus opératoire qu’un autre, cernant une différence qui paraît fondamentale à un moment, pour que des ‘mythes’ ou des ‘contes’ viennent s’en amuser. Invariablement, ce critère vient buter sur des récits exotiques qui refusent de se prêter au jeu. Malgré ces pieds de nez facétieux de l’empirie, personne ne semble vouloir renoncer à ces taxinomies.
Explorant le terme mythe dans les dictionnaires, entre autres théologiques, examinant les fichiers des bibliothèques, j’en suis venue à penser que le XXe est LE siècle mythifié /mythifiant par excellence. Non pas retour du sacré (comme il est dit), mais son renforcement dans la répétition multipliée du même.
Laissant les mots, je revins résolument aux choses pour éviter les pièges sémantiques qui font des mots des ‘réalités’. Comme y invitait de Saussure. Et les choses, c’étaient les récits eux-mêmes, leur fonctionnement, leur statut…
En allant des formes obliques modernes (récits extra-ordinaires) aux formes traditionnelles et vice-versa, les soupçons flous que j’avais nourris devinrent certitude. Le mythe — comme récit spécifique — ça n’existe vraiment pas ! C’était une invention qui avait des fonctions dans la pensée occidentale, du XXe siècle en particulier, et dans l’économie intellectuelle/psychique de nombreux sujets pensants. Et aussi, un artefact réifié du discours performatif (ceci est un mythe, ceci n’est pas un mythe..., ceci est un mythe dégradé en conte… Et d’apporter ses ‘preuves’, “ce récit est moins cosmique” que le précédent désigné comme mythe… et donc, c’est un conte).
Comment se débarrasser d’un objet aussi juteux en cette fin de 2e millénaire ? Folie ? Utopie?
[…]
C’est en prenant connaissance de la polémique que votre livre avait déclenchée, que j’ai mesuré l’insensé de mon entreprise. J’ai toujours su que je m’aventurais sur des terrains minés ! Ce ne sont pas des mines, mais des chars d’assaut qui veillent sur le mythe ! L’enjeu étant économique. Aussi.
Mon point de départ est très différent du vôtre, et ma démarche aussi. Mais les conclusions se recoupent. Comme elles recoupent, celles de nombreux américanistes, dont Franz Boas.
J’espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Ni trop embarrassé par mes questions.
Croyez, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.
P.-S. Sur le sexe des récits ‘mythiques’.
Je ne pensais pas qu’on pût généraliser le constat que vous aviez fait dans un entretien radiophonique sur France-Culture. Dans la littérature « exotique » AUSSI, les récits mythiques, ces paroles-dites-off, venant d’un passé lointain, transmis par des machines enregistreuses, sont, ne sont que des discours au masculin, sur le monde, sur les femmes, sur les hommes eux-mêmes et leurs difficultés avec le féminin. Ces récits constituent une riche panoplie de fantasmes masculins, singulièrement répétitifs ! Universellement répétitifs. Paroles au masculin, «recommencées» en permanence, en vue de maintenir un certain ordre, toujours menacé par le féminin ? En bref, une imposture généralisée, qui transforme la parole singulière d’une moitié de l’humanité en parole de l’humanité tout entière. Les conditions de la collecte des récits dans le sociétés « traditionnelles » contribuant à accréditer l’imposture, la voix des femmes étant «naturellement» absente. C’est précisément cette absence qui a permis à de trop nombreux anthropologues, ethnologues d’imposer ces paroles comme paroles de LA communauté, passant sous silence les conditions de la collecte. Bateson y fait allusion dans la Cérémonie du Naven, il s’était fâché pour avoir le droit d’interroger les femmes qui selon les hommes n’avaient rien à dire. En 1930, c’était un pionnier. Les femmes ethnologues, aussi ont négligé les femmes. Denise Paulme regrettait en 1977 de n’avoir pas «travaillé avec les femmes». Outre l’habitus dont Bourdieu a montré les mécanismes qui participent de la reproduction des représentations aliénantes, il faut ajouter le statut ambigu de la femme ethnologue à l’intérieur de la discipline et sur le terrain. Robert Delavignette tenait Denise Paulme pour “un honnête homme” !
La perte n’est pas mesurable, des points de vue anthropologique, sociologique d’abord, car là où des chercheurs s’intéressent aujourd’hui à cette parole, on entrevoit d’autres représentations. Souvent critiques à l’égard de la gente masculine ! Du point de vue littéraire ensuite. Ce dont témoignent les travaux de Milan Stanek* chez les Iatmul, qui rapportaient des récits au féminin, ouvrant sur des imaginaires nouveaux dans le champ ethnologique. 27 femmes sur 49 personnes y furent interrogées. Le récit qui met en scène des rapports fille/mère, Ammuyaragwa, est un beau poème où s’engendre le fabuleux. La conteuse avait manifestement plaisir à évoquer l’apparition de la mère-donatrice, la plantureuse plénitude de cette généreuse forêt qui glisse sur l’eau du lac, en fouette les vagues. Un regard de femme sur la femme nourricière, source de vie, pensée sur le mode analogique, avec la nature**. Eluard eût aimé.
De plus, même quand, dans les sociétés à écriture, des récits peuvent être repérés, comme récits au féminin, il faut la patiente rigueur d’historien/nes pour y retrouver une parole de femmes. Tel le récit du Petit chaperon rouge***.
En guise de conclusion, une citation de sociologue africain :
« … Je dirai simplement comment j’ai été amené aux choses des femmes. Un jour que j’interrogeais un vénérable vieillard, sur les rites initiateurs chez les Bëti, une femme d’environ quatre-vingts ans vint s’asseoir à côté de moi et me dit sans ambages: “Mon fils, pourquoi oublies-tu la femme ? Fœtus, je te porte dans mon ventre, bébé je te porte sur ma poitrine; enfant, je te porte sur mon dos ; adulte, je te porte sur mes genoux (allusion à l’acte sexuel) ; et quand je cesse de te porter, c’est que tu es mort ! Pourquoi oublies-tu la femme ?»
« C’est à partir de cette question angoissante que j’évolue avec timidité dans le monde des femmes bëti et notamment dans un domaine particulièrement délicat: celui du rituel.»
Henri NGOA, in Colloque d’Abidjan sur Les rites féminins chez les Bëti, Région du centre-sud au Cameroun, 1985:9
✥
* STANEK Milan, Sozialordnung und Mythik in Palimbei, Bausteine zur ganzheitlichen Beschreibung einer Dorfgemeinschaft der Iatmul, East Sepik Province, Papua New Guinea, Bâle, Basler Beiträge zur Ethnologie, Musée d’Ethnologie, 1983, Bd.23.
** Je publierai ultérieurement l’analyse de ce récit.
*** Cf. le beau travail de BRICOUT Bernadette, « L’aiguille et l’épingle, Oralité et écriture au XVIIè siècle » in La Bibliothèque bleue nel siecento, O della litteratura per il popolo, Prefazione du G. Bolleme, Adriatica-Bari/Nizet, Paris, 1981, p. 45-58]
feliepastorello-boidi©
✥
III. 2.
À mon retour de Chine où je séjournais un mois et demi en janvier 1993, j’adressai la lettre qui suit à une collègue, Madame Meng Hua, Professeure, rencontrée à Pékin, qui avait fait une thèse sur Voltaire et la Chine. Cette seconde lettre colore d’un autre point de vue le paysage intellectuel des années 1954 (Brecht) et post-68.
Paris, le 14 février 1993
Madame et chère Collègue
Comme promis, je vous envoie les informations sur le n° de la revue Théâtre populaire, consacré au Théâtre chinois : n° 14, juillet-août 1955 avec quatre essais :
Claude ROY, Quelques clefs pour le théâtre chinois
Paul ARNOLD, Techniques
TCHAO FONG, Aspects actuels
BRECHT, Remarques sur le comédien chinois
Et une pièce : Les Adieux à la favorite, tragédie chinoise.
En cherchant le numéro consacré au théâtre chinois, j’ai noté que Théâtre populaire ne s’était pas contenté de faire connaître la théorie, mais qu’on y proposait aussi des traductions de pièces [n° 42, 1961 ; n°43, 1961 ; n°49, 1963]
De quelques informations rapides complémentaires qui vous permettront de situer la revue et donc la fonction de « la Chine », informations qui recoupent notre conversation, mais de manière moins anarchique.
1. Le numéro 14 (1955) consacré au Théâtre chinois. est précédé du numéro 11 (1955) consacré à Brecht, la découverte du théâtre chinois est donc étroitement liée à la découverte de Brecht. Le grand choc de l’année 1954.
2. Cette revue s’inscrit dans deux directions principales :
a) comme son titre l’indique, Théâtre populaire, s’inscrit dans le mouvement de politique culturelle de décentralisation (création des Maisons de la culture, dans la périphérie de Paris, en province par des maires de gauche, en particulier). Des metteurs en scène désirent s’adresser à un public plus large, ‘populaire‘. Le théâtre va dans les entreprises, les usines. Gérard Philippe, acteur de cinéma très populaire à l’époque, rejoint Vilar, ‘le pape’ du Théâtre populaire au Palais de Chaillot. Vilar monte Mère Courage de Brecht, en 1951, pièce qui fait frémir d’horreur les critiques, défenseurs du modèle racinien, c’est-à-dire en fait le modèle aristotélicien. Époque de la création du Festival d’Avignon. Etc.
[Précisons que le théâtre s’adressait, en France, principalement à un public bourgeois avec un répertoire conventionnel, fait pour être vu après les dîners].
b) D’autre part, à travers ses rédacteurs, elle participe aussi, dans le champ théâtral, des mouvements de critique théorique qui émergent en France dans les années cinquante et ne cesseront de se développer les décennies suivantes, renouvelant de nombreuses questions.
Roland Barthes*, qui s’est très tôt intéressé au théâtre, ouvre le N° 11 de Théâtre populaire avec son fameux manifeste : « Enfin Brecht vint … ». Dans ce débat théorique, critique, la découverte progressive de Brecht à partir de 1954 va jouer un rôle déterminant, et à travers lui le théâtre chinois.
En d’autres termes : le théâtre chinois via Brecht va servir d’arme de combat à la fois contre une certaine conception traditionnelle du théâtre (en schématisant : théâtre aristotélicien VS théâtre épique) et contre les approches non moins traditionnelles du texte théâtral, de la gestuelle, etc. Insistance en particulier, au plan théorique, sur l’anti-naturalisme radical du théâtre chinois, point qui intéresse particulièrement Brecht, dans sa réflexion théorique.
c) Un effet intéressant en France: la relecture des classiques français [le Sur Racine de Barthes (1963), et les mises en scène très neuves de Molière, Corneille… par des metteurs en scène admirateurs de Brecht].
3. La ‘découverte’ du théâtre chinois développera sa propre dynamique. Plus tard, dans Tel Quel et les revues que le groupe colonise, la peinture chinoise jouera également un rôle important dans les combats théoriques et d’une manière plus générale, la culture chinoise, vue aussi à travers les textes de Mao. Il s’agit donc toujours d’une connaissance médiatisée, filtrée, et politique (revue et corrigée à la mode occidentale ? )
[J’avoue que j’aimerais savoir le nombre de “bêtises” qui ont pu être écrites sur la Chine, à l’époque, et seuls des Chinois pourraient nous le dire ! Vous aviez du reste fait allusion à cette incompréhension des sinologues. Un étudiant congolais m’avait dit la même chose des africanistes ! C’est du reste un des reproches majeurs faits aux Occidentaux dans différents textes théoriques : annexer l’autre pour parler de soi et/ou l’instrumentaliser pour parler de soi et/ou ramener l’autre à soi, c’est-à-dire ne voir jamais que du même].
Les fonctions de la Chine dans ces revues pourraient faire l’objet d’un beau travail de recherche. Certaines de ces fonctions doivent, quelque part, recouper certaines fonctions de la Chine chez Voltaire, en particulier à travers les stratégies offensives/critiques !
4. Travail Théâtral, revue plus tardive, a également consacré des articles au Théâtre chinois et toutes les petites revues maoïstes évidemment. C’était un sujet à la mode. Il serait intéressant de faire une comparaison avec les revues allemandes : j’y jetterai un oeil un jour.
5. Des auteurs (Brecht en Allemagne, Vinaver en France) ont aussi traité de ‘sujets’ chinois (légendes, fictions).
En résumé donc .
Les discours sur « la Chine » s’inscrivent donc un champ très vaste, fait d’emboîtements de théories, d’interactions, inscrit dans la longue durée, allant des années 20 aux années 70 : artistes russes, allemands, français, anglais, américains des années 20, renouvellent théories et pratiques artistiques. Les cultures non européennes deviennent arme de combat (art africain, océanien, chinois). En Russie, Meyerhold s’intéressait au théâtre chinois, à la comedia del arte, etc, c’est-à-dire aux formes théâtrales différentes du théâtre dominant. Maïakovski, entre autres, voulait une Russie tournée vers l’Asie. Dans les années 1960-1970 suivront les réactivations de leurs théories, de leurs combats à travers la découverte des formalistes russes, les travaux linguistiques de Roman Jakobson, la découverte de Brecht. Etc.
Ces discours qui subvertissent les champs artistiques participent eux-mêmes d’un très vaste ensemble de critiques théoriques qui bousculent toutes les disciplines des Sciences humaines. Je dirai même qu’on ne peut pas comprendre l’essor des sciences dites dures, si on ne considère pas ce travail de décapage théorique, épistémologique, qui a permis de poser de nouvelles questions. En particulier à travers les problèmes du langage, du sens, qui pousseront les logiciens à toujours plus de formalisation mathématique pour échapper aux pièges des mots.
Que les luttes fussent traversées de contradictions internes (débats violents entre les admirateurs d’une certaine Chine et certains sinologues), qu’il y ait eu des dérapages dogmatiques, sous couvert de théorie, est évident. Mais la fine dialectique chinoise nous a appris que rien n’est jamais positif ou négatif, mais toujours positif et négatif. Il est dommage du reste que cette forme de dialectique n’ait pas plus marqué la pensée occidentale, qui reste toujours profondément dualiste. Peut-être est-on passé à côté de ce que la pensée chinoise pouvait nous apporter de plus fort ! Son sens des discriminations subtiles et son sens des interdépendances systémiques. Un autre beau sujet de recherches à dimension anthropologique et philosophique pour votre centre de recherches ! Ce qui explique peut-être, d’une certaine manière, l’incompréhension des Occidentaux à laquelle, vous faisiez allusion.
Je vous enverrai le livre consacré aux Avant-gardes des années vingt (CNRS) ultérieurement. (J’espère qu’il n’est pas épuisé).
J’imagine que vous avez repris le travail. Je vous souhaite donc bon courage !
P.-S. du 16. 02.
Depuis que je suis rentrée, apparaissent de nombreux articles sur la Chine. Après la Chine maoïste, c’est la Chine ‘capitaliste ‘ et la vieille Chine impériale qui deviennent à la mode ! Pourquoi ? Il serait intéressant d’analyser cette nouvelle mode ! La Chine ‘capitaliste’ servirait-elle à faire peur, aux capitalistes eux-mêmes ?
Comme si les grands travaux collectifs n’appartenaient pas à la tradition chinoise. Parce que les Chinois font ce que nous faisons, c’est-à-dire vont visiter les lieux de mémoire, ils nourriraient la nostalgie d’un passé — impérial ! Les voilà passéistes ! Quelle revanche sur la maoïsme ! Encore un effet de la pensée dualiste : on est ceci ou cela, jamais ceci et cela ! Du nouveau, de l’ancien, de l’archaïque, de l’utopique, de la mémoire, de l’oubli, bref de l’histoire, nécessairement ouverte, puisque le futur malgré nos efforts reste imprévisible. Ce que montrent et démontrent toutes les prévisions statistiques, qui se prétendent scientifiques, sur le futur de nos sociétés.
Les Chinois devraient créer un centre de recherche sur les images de la Chine, analyser les fonctions de ces images. déformées, déformantes. Il y faudrait des chercheurs de disciplines différentes et pas seulement des sinologues. Exemple : pourquoi les journaux ont-ils tant parlé du viol de jeunes chinoises par des groupes d’hommes plutôt sadiques ? À lire nos journaux, j’avais eu le sentiment, que les jeunes femmes pouvaient se faire violer à tous les coins de rue ! comme à New York ou à Los Angelos (un viol toutes les cinq minutes, dit-on). D’une part, je n’ai jamais éprouvé le moindre sentiment de danger dans cette immense ville — (car même la circulation apparemment anarchique à des règles, et quand on les a comprises, on traverse avec moins d’inquiétude qu’à Paris, où on peut se faire renverser dans les passages cloutés). Et d’autre part, j’ai eu le sentiment très fort que les femmes chinoises occupaient une place importante avec une énergie fabuleuse, je n’ai pas réussi à voir en elles des victimes potentielles.
Alors ? Un fait réel de société ou un fait divers monté en épingle par des journalistes ? Dans quels buts ?
feliepastorello-boidi©
✥✥
ANNEXES du FRAGMENT b
Le temps des désenchantements
IV. Le discours victimaire comme alibi paresseux
Une étudiante «fille d’O.S.», intelligente, mais cossarde m’écrivit pour infléchir une note. Elle provoqua un coup de colère qui s’est déposé dans la lettre et sur la barre du t (de mon nom) qui ressemble par sa longueur à un coup de sabre ! J’avoue ne pas supporter le discours victimaire-alibi, et l’indulgence compatissante ‘de gauche’. Une forme de mépris à mes yeux. C’est parce que les enseignants de Français de ma scolarité n’ont pas accepté mes fautes de Français que j’ai progressé, apprenant à tout vérifier. C’est parce que M. Colleville collait un étudiant en thème avec une seule faute de grammaire que j’ai acquis des bases solides en grammaire allemande… Et ainsi de suite.
Le 10 Octobre 1984
Mademoiselle,
Je manque de temps, et ces échanges épistolaires m’ennuient.
Si je vous réponds, c’est parce que votre lettre contient un argument méprisable et méprisant. Faire état de votre qualité d’ «émmigrée» pour tenter d’infléchir un changement de note (enregistrée depuis juin au rectorat), choque la fille d’immigré que je suis moi-même (mon père est italien) ; c’est tenter de faire jouer des mécanismes de racisme à l’envers. De quels arguments pourraient arguer vos camarades «non-immigrés» ? Il faut donc un certain mépris de l’autre pour penser qu’il puisse être sensible à une telle argumentation. Pour moi, vous êtes une étudiante avec le mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Rien de plus et rien de moins.
Récapitulons :
1) vous ne faites pas votre exposé oral, prétextant que vous étiez fatiguée; l’après-midi, je vous aperçois dans les couloirs de la faculté ;
2) à la veille des examens, vous commencez à vous inquiéter et téléphonez pour que je vous écoute à la date qui vous convient ;
3) le jour de l’oral, vous me dites avoir envoyé votre devoir à mon adresse personnelle, «il y a quinze jours» ;
4) en fait, je reçois votre copie, après la délibération, le cachet de la poste est du 12 juin 1984 ;
5) ni en juin, ni en octobre, vous n’avez la moyenne à l’épreuve de M. Chardin. Si le redoublement eût été si dramatique que vous le dites, vous auriez dû faire un effort sérieux pour la cession d’octobre. Mais, vous êtes comme vous l’écrivez «prête à vous battre» pour obtenir les deux points qui vous «manquaient» (avec le jeu des coefficient, il s’agit en fait de 3 points).
Il m’est souvent arrivé d’intervenir pour aider un/e étudiant/te en difficulté, victime d’une injustice, et de manière efficace, mais chaque fois, j’étais motivée par le sérieux de l’étudiant/te en question.
Si vous redoublez, ce n’est pas parce que vous avez été «recalée en 415», c’est parce sur 4 UV, vous êtes obligée d’en refaire trois : Latin, Vieux-français et 415.
Ni M. Chardin, ni moi-même n’interviendrons auprès du rectorat pour faire changer votre note de contrôle continu.
Un conseil : avant de compter sur l’indulgence du jury, commencez par compter sur vous-même. Au lieu de vous « battre » pour cette indulgence qui vous apparaît comme un dû («vous auriez pu être indulgente» écrivez-vous), travaillez un peu plus et vos résultats seront meilleurs. L’université n’est pas une entreprise de charité.
✥✥✥
Temps des combats
Temps des rénovations pédagogiques
Temps des repliements, désertions
✥✥✥✥
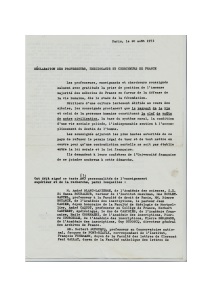

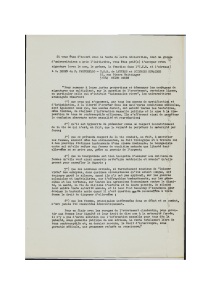
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.